Arches du vent de Pierre Voélin par Lionel Bourg
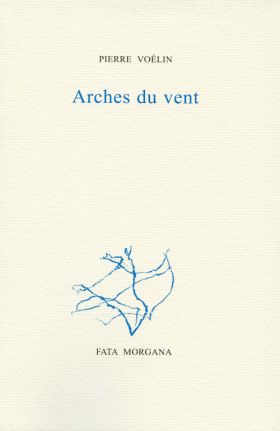
Si décevante, si veule parfois, la poésie reste « après toutes les déceptions qu’elle [nous a] déjà infligées » – l’expression, reconnaissable à sa frappe, provient de La confession dédaigneuse, d’André Breton, texte que j’engage le lecteur distrait par les controverses du temps à redécouvrir –, la seule forme de conscience capable d’intégrer à notre inquiétude les dehors d’un monde qui, distant toujours, soumis aux lueurs capricieuses de l’aube ou du crépuscule, parce que nôtre, totalement nôtre, serait-il pour une part crédité d’un hypothétique vernis naturel, nous est devenu peu à peu étranger.
Deux livres de Pierre Voélin nous le rappellent aujourd’hui.
Le premier, Les bois calmés, était connu de quelques amateurs. Publié par La Dogana en 1989, son édition nouvelle redonne accès à un ouvrage grave, navré d’une blessure inguérissable, le deuil qu’elle annonce, comme universel et chargé du chagrin propre à la perte d’un père ou d’un ami, d’une femme, d’un enfant, maculant mot après mot nos lèvres assoiffées de silence. La nuit vient. Il y faut
reprendre cette marche à la pourriture
longuement goûter la saveur de la boue
avant de s’en remettre au « froissement de la lumière ».
Pierre Voélin jamais ne pèse.
Bref, découpé au tranchant du silex ou de la faux, son poème n’assiège ni ne menace à hauts cris les remparts des cités bavardes mais, simple, apparemment, ses membres désarticulés avec justesse et précision afin de mieux s’unir dans l’obscurité que trouent les étoiles, ne s’armant pas plus de grappins qu’il ne lance à l’assaut du néant d’incertaines échelles, précaire, en somme, les cicatrices qu’il rouvre, puis referme, rouvre, referme, dessinent aux veines du poignet la corolle où soufflent et s’épuisent et renaissent tant de vents contraires. Se plaindre ? Vaticiner ? D’autres s’en acquitteront. Homme des frontières, Voèlin, qui n’ignore pas les routes principales, préfère emprunter les sentes discrètes, lieux qu’il aime et où personne n’assène ses convictions à coups de marteau, la dissidence, ici, jurassienne, ne s’encombrant que d’un bâton de coudrier, de chiches graminées, de chèvrefeuille et d’épilobes.
Dès lors, le poète ne chante qu’en sourdine. Fredonnant, il n’affirme rien, il énonce, et sa voix, mais d’emblée je ne parle que du second recueil, Arches du vent, module son registre ou ses accents selon des modalités vierges et immémoriales à la fois : la neige est froide, mêlée d’astres perdus et de plumes d’effraies clouées aux portes des granges, la bruyère pleure, les lilas enlacent des visages rougis par la fièvre que les jeunes gens ressentent quand ils échangent sur un banc de fougueux mais timides baisers.
Question de délicatesse, il me semble.
D’une douleur presque indicible, poignante au creux de chaque page, l’impossibilité même de traduire de telles afflictions nourrissant l’exigence d’un auteur en quête d’authenticité. Comment ne pas être touché, ému par la présence de ce qu’il nomme ainsi les « choses », lesquelles ne diffèrent pas de celle qui tombe, heureuse, au terme des élégies de Rainer Maria Rilke. L’effroi, la ferveur en émanent. Fruits, herbes folles, matière impalpable des heures et des minutes, cailloux, aubier, écorce, choses, donc, la souffrance que l’on éprouve à les savoir offertes mais hors d’atteinte ne cesse de croître, se délivrerait-elle un instant en caresse.
Or cette présence, minérale souvent – calcaire, granitique –, florale, animale sitôt qu’un rouge-gorge s’enferme dans « la cage d’air des doigts réunis », ne répond pas, chez Pierre Voélin, à l’injonction d’une quelconque épiphanie de l’élémentaire. Profondément humaine, pétrie des sentiments les moins sordides, les moins contestables de nos pareils, sa poésie s’émancipe de tout substrat prétendu primordial pour, verre pilé sous les mains, amandes, noisettes des regards, pollen d’un sourire, concentrer en ses vers l’effarante candeur comme « l’âpreté du fait de vivre ».
Bien sûr, il y a la mort.
Cette clarté méchante « qui palpe nos crânes et nos genoux ».
Les larmes. L’incompréhensible tourment qui nous penche sur « une tombe d’orties blanches ». Des bouquets ou de minuscules pâquerettes de givre. Un ciel jonché d’oiseaux. Des rires ou l’apaisante chaleur d’un chat sur la chaise voisine. Un feu. La respiration d’une bûche. La braise que l’on tisonne dans l’âtre où se consument les souvenirs de vies désemparées.
Il y a des insectes qui crépitent. Une mante religieuse près du mur de la maison. Un fleuve « pensif ». Des grands-parents assoupis et des enfants, des enfants surtout, fillettes ou tendres garnements des prés et des bois dont ils ne fréquentent que d’assez confuses lisières, des mioches, oui, qui courent à perdre haleine par les brandes, hurlent, galopent ou s’immobilisent au pied d’un saule dont le feuillage s’incline à frôler les eaux de la rivière si longtemps interdite. On les entend alors. Surprend leurs conciliabules. Devine les secrets qu’ils partagent. Compose avec eux la fable qu’ils se répèteront les soirs de peur ou de désarroi en amont du sommeil.
Ils chialent aussi.
Reniflent et se taisent « tant que dure la nuit du sang », s’éloignent sous « des soleils boiteux », de « courtes pluies » qui, de leurs dents, grignotent digitales et fougères. Survivre, promettent-ils,
Survivre – et se hâter
à la bouche ce goût de solitude
et sur l’épaule un pâle chandail de cendres
On se vêtirait d’une humanité moindre.
De haillons au besoin. De châles ou de guenilles : la beauté n’est pas une parure.
Cela n’a d’ailleurs plus vraiment d’importance. Je vais de poème en poème. Flâne. M’attarde. Il pleut. Ou il fait beau. Et si le dieu que suggère Voélin, ce dieu vague, insaisissable, auquel je ne crois pas, malgré mon déni nimbe d’étoles et de lambeaux d’azur les choses que j’ai dites, il ne me gêne pas, n’étant à cet égard qu’une façon de nommer le mystère de toute existence. Pierre Chappuis, Rilke, Mandelstam, René Char, Paul Celan, Gérard Manley Hopkins, Pierre-Albert Jourdan, et Philippe Jaccottet, et Gustave Roud, Leopardi, Hölderlin foulent des contrées analogues. Près d’eux, les lisant, je suis « comme un vieillard qui rêve ». La suite ne me démentira pas :
parole n’est que murmure,
et la nappe devient plus blanche,
s’allument des bougies – au nord du cœur,
sous l’appel tendre – et la caresse,
des oiseaux quittent en feu le cadran de minuit.
Et voici le bruit – et les sabots sur le pavé
qui portent au loin la clef, la pluie et le cimetière.
laquelle s’apparente, et par son contenu renvoie, au très sensible ensemble de proses intitulé De l’enfance éperdue*. Décidément, Pierre Voélin nous est indispensable.
* Éditions Fata Morgana, 2017.